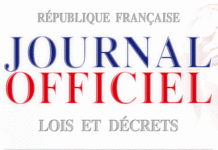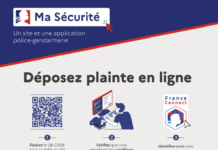Publié le 15 octobre 2025, un rapport présenté devant la commission des lois de l’Assemblée nationale dresse un bilan nuancé de la réforme de la Police nationale, entrée en vigueur en janvier 2024. Rédigé par les députés Thomas Cazenave (Ensemble pour la République) et Ugo Bernalicis (La France insoumise), le document salue certaines avancées tout en soulignant de sérieuses limites opérationnelles.
Une réorganisation ambitieuse mais incomplète
Cette réforme, initiée en 2020, a profondément modifié l’architecture de la Police nationale. Elle a regroupé, au sein de chaque département, les services du renseignement, de la sécurité publique, de la police judiciaire et de la police aux frontières sous l’autorité d’un directeur départemental unique, placé sous la responsabilité du préfet.
L’objectif affiché était de mieux coordonner l’action policière et d’adapter la réponse sécuritaire aux réalités locales. Cette départementalisation avait néanmoins suscité, dès sa conception, une forte contestation dans les rangs de la police judiciaire.
Des gains de coordination, mais une efficacité difficile à mesurer
Selon les rapporteurs, cette nouvelle organisation a permis de rompre avec le cloisonnement des anciennes directions centrales, en donnant davantage de latitude aux responsables départementaux.
Cependant, les élus peinent à mesurer une réelle amélioration de l’efficacité globale : « Il est difficile d’affirmer que la réforme renforce concrètement l’action policière », reconnaît Thomas Cazenave.
Les deux députés partagent ce constat, tout en divergeant sur les solutions à adopter pour corriger les dérives observées.
Le risque d’un repli départemental
Les principales critiques portent sur le recentrage excessif au niveau départemental, qui pourrait nuire à la lutte contre les phénomènes criminels dépassant ces frontières, notamment dans le domaine de la criminalité organisée.
« La départementalisation n’est pas la maille pertinente », estime Ugo Bernalicis, qui plaide pour une vision plus transversale de la police judiciaire.
Le rapport note aussi que la réforme a parfois créé une confusion des niveaux de responsabilité, le maillon zonal cherchant encore sa place dans la chaîne hiérarchique.
Des moyens toujours centralisés
Autre point sensible : la réforme n’a pas entraîné de véritable déconcentration logistique. Les rapporteurs constatent au contraire une recentralisation partielle des effectifs au niveau zonal. En revanche, la crainte d’une ingérence préfectorale dans la conduite des enquêtes, souvent évoquée avant la mise en œuvre de la réforme, ne s’est pas confirmée.
Une crise persistante de la police judiciaire
Le rapport confirme la désaffection croissante pour la filière judiciaire, marquée par un manque d’attractivité et des moyens sous tension.
« La réforme n’a pas réglé la crise d’attractivité de la police judiciaire, même si elle ne l’a pas aggravée », observe Thomas Cazenave.
Certains acteurs estiment même qu’elle aurait accentué les difficultés, en mobilisant des moyens de la PJ sur des missions locales au détriment de l’investigation nationale.
Deux visions opposées pour l’avenir
Sur le plan structurel, les deux députés divergent.
Ugo Bernalicis propose la création d’une direction générale de la police judiciaire (DGPJ) afin de recréer un ensemble cohérent, sur le modèle de la DGSI, pour mieux coordonner les moyens humains et matériels.
Thomas Cazenave s’y oppose fermement, redoutant un retour à une organisation en silos. Il prône au contraire un renforcement des synergies interservices et une mutualisation accrue des moyens.
Une réforme à poursuivre
Les deux parlementaires s’accordent néanmoins sur un point : il sera nécessaire d’apporter des ajustements ciblés et de mener d’autres évaluations à moyen terme.
Leur conclusion est claire : la réforme a ouvert un chantier majeur de modernisation, mais son efficacité réelle reste à démontrer.
Photo de Brian Huynh sur Unsplash